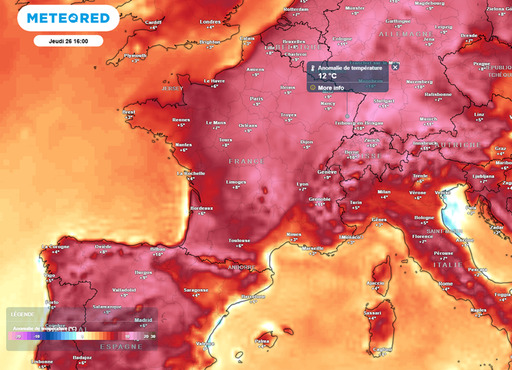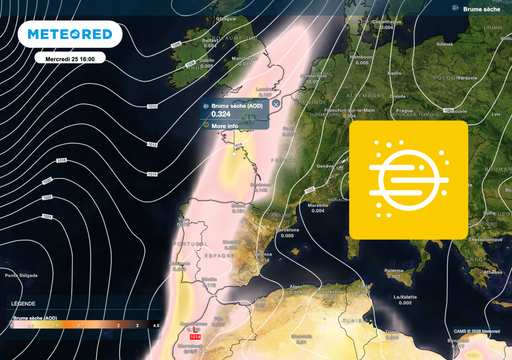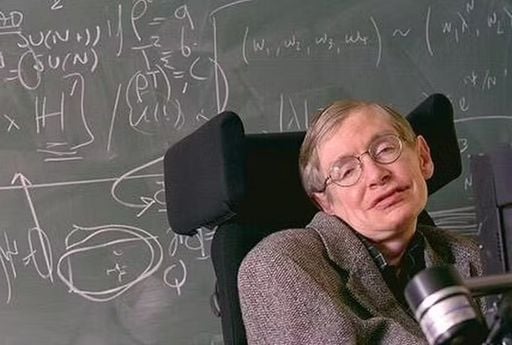Pluie, averses, ondées, grains, giboulées : quelles différences entre tous ces termes qui évoquent des précipitations ?

Au sein d'une semaine très humide, perturbée et plus fraîche sur la France, toute la panoplie des précipitations est de sortie : pluie, averses, grains, ondées, giboulées… Quelles sont les différences entre tous ces phénomènes météorologiques ?
Vous l'avez tous remarqué, cette semaine est bien plus humide et perturbée en France que la précédente : à la clé, le retour de la pluie dans certaines régions, des averses dans d'autres, voire des giboulées… On parle par endroits d'ondées, mais aussi de grains : est-ce la même chose ? Quelles différences entre tous ces termes qui évoquent des précipitations ?
Les fameuses giboulées de mars :) #nancy pic.twitter.com/yW6UTMvg6I
— Jérôme PROD'HOMME (@Jeromeprodhomme) March 13, 2025
En termes de sensation, le résultat est le même : pluie ou averses, vous serez quoiqu'il arrive mouillés et généralement mécontents… Météorologiquement parlant en revanche, il s'agit de phénomènes distincts, avec des différences de durée, d'intensité et même de prévisibilité.
De l'averse à la drache, il n'y a qu'un pas !
La pluie se produit généralement sous un ciel couvert, très gris, bas, qui matérialise l'existence d'une perturbation dans l'atmosphère, qui elle marque le conflit entre deux masses d'air, de l'air froid et de l'air chaud. La pluie est constante, faible à modérée, plutôt facile à prévoir, on la voit arriver sur l'image radar, et durable : une, deux, trois heures, parfois toute la journée.
Les averses, elles, sont soudaines, intenses, brèves et éphémères, de quelques minutes à moins d'une heure, entrecoupées d'éclaircies. Elles marquent souvent l'instabilité, et sont observées le plus souvent sous des nuages ressemblant à des choux-fleurs, les cumulus, ou à des enclumes, les cumulonimbus ou nuages d'orages.
Elles se déclenchent généralement en cas d'importante différence de température entre la haute altitude et le sol, et sont très difficiles à localiser : elles peuvent concerner un village et pas un autre, c'est pour cela qu'on évoque souvent un "risque d'averses" dans nos prévisions.
Si tout le monde connaît le mot #averse, nombreux sont ceux qui disposent dun autre mot pour désigner une pluie soudaine et intense comment tu dis dans ton coin ? pic.twitter.com/pCSDbv7831
— Mathieu Avanzi (@MathieuAvanzi) August 19, 2023
Quand au mot "averse", il vient du terme "verse", qui correspond à un phénomène agricole : lorsque les cultures se couchent au passage de violentes pluies, on parle de "verse". L'ondée, elle, est un synonyme de l'averse. Quant au grain, il s'agit d'une averse qui se produit en mer ou près des côtes et que les marins connaissent bien, avec une accélération très temporaire et brusque du vent.
Il y a évidemment les giboulées, averses qui mélangent la pluie, la grêle, le grésil et parfois la neige ou la neige fondante. Dans certaines régions, le mot averse est remplacé par du patois local : ainsi, on parle de "drache" dans les Hauts-de-France, de "chawée" en Lorraine, de "ragasse" en Bourgogne, de "rouchatte" dans le Roussillon, ou encore de renapée dans la Sarthe.