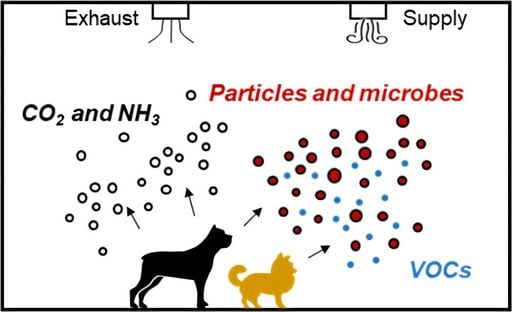Les montagnes grandissent-elles ? Quel rôle joue l'érosion ? Voici ce que dit la science !
Les montagnes croissent et changent constamment en raison de la tectonique des plaques et de l'activité volcanique. Cependant, l’érosion et la gravité imposent des limites. Jusqu'où peuvent-ils aller ? Nous vous l'expliquons dans cet article.

Les montagnes ont été et sont des symboles de majesté et de puissance à travers l’histoire, mais ce sont aussi des structures dynamiques en constante évolution. Même si nous avons tendance à les considérer comme des formations géologiques statiques, la réalité est qu’elles se développent… mais s’érodent également.
Jusqu'où peuvent-elles grandir ? La réponse réside dans la géologie, la tectonique des plaques et les lois de la physique.
La tectonique des plaques : la force motrice du relief terrestre
Les montagnes sont formées par la poussée de la croûte terrestre car la planète n'est pas une structure rigide, mais est composée de plaques tectoniques qui se déplacent lentement sur le manteau.
Il s’agit d’une grande partie de la couche externe de la Terre qui se déplace lentement sur le manteau. Ces plaques peuvent entrer en collision, se séparer ou glisser les unes contre les autres, provoquant des tremblements de terre, des volcans et la formation de montagnes.
Lorsque ces plaques entrent en collision ou se chevauchent, elles génèrent d'énormes forces de compression qui plient et soulèvent la croûte, formant de grandes chaînes de montagnes telles que l'Himalaya, les Andes ou les Alpes.
Toutes les montagnes ne se développent pas à cause de collisions de plaques. Certaines le font en raison de l’activité volcanique, et par exemple les volcans sont formés par l’accumulation de lave et de matériaux pyroclastiques qui émergent de l’intérieur de la Terre.
Nuevo mapa de distribución de placas tectónicas.
— IGEO (CSIC-UCM) (@IGeociencias) June 9, 2022
Debido a la inexistencia de un límite claro en algunas áreas, y como novedad, se establecen amplias zonas como límite de placa, como es el caso del sur de la Península Ibérica
Imagen: Derrick Hasterok, Universidad de Adelaida pic.twitter.com/0PNscNkR7c
Au cours de multiples éruptions, ces structures peuvent atteindre des hauteurs considérables en raison de cette succession de processus éruptifs, comme c'est le cas du Kilimandjaro (5 895 mètres), du Mauna Loa ou Mauna Kea hawaïen, ou du Teide (3 715 m). Cependant, cette croissance n’est pas illimitée et certains facteurs limitent l’altitude maximale qu’une montagne peut atteindre.
Quelle serait la hauteur ou l’altitude limite des montagnes terrestres ?
Les mêmes forces qui soulèvent les montagnes doivent également lutter en permanence contre les agents érosifs. Au fil du temps, le vent, l’eau, la glace et les changements de température usent les roches et réduisent la hauteur des montagnes.
Les glaciers, en particulier, ont façonné de nombreuses chaînes de montagnes à travers l'histoire, creusant d'imposantes vallées en forme de U, créant des crêtes et adoucissant certains pics.
If you measure down to the seafloor, Mauna Kea is the tallest mountain on Earth (but only 8th in the solar system). pic.twitter.com/3vDUur4qJH
— Weird Science (@weird_sci) July 10, 2016
Pour toutes ces raisons, il est très difficile d’établir une limite à l’altitude maximale que les montagnes pourraient atteindre. Mais il y a un cas qui dépasse les 10 000 mètres : il s'agit du gigantesque volcan hawaïen Mauna Kea, qui mesuré depuis sa base au fond de l'océan atteint 10 203 mètres.
La limite gravitationnelle : quand les montagnes s'effondrent
En plus de l'érosion, la gravité elle-même impose une limite puisque, à mesure qu'une montagne grandit, son poids augmente et ses fondations commencent à s'enfoncer dans le manteau terrestre. Ce phénomène, connu sous le nom d’isostasie, provoque l’affaissement des bases des montagnes pour équilibrer le poids du soulèvement.
¿Cómo sería Groenlandia sin su casquete glaciar?
— IGEO (CSIC-UCM) (@IGeociencias) September 1, 2021
Esta imagen con el relieve exagerado, muestra un gran valle en su interior de más de 750km de longitud, que drenaría hacia el mar y explicaría la ausencia de lagos bajo la masa helada
Imagen: J. Bamber, Universidad de Bristol pic.twitter.com/stHTg60fyU
En termes simples, la montagne commence à « couler » très lentement, comme s'il s'agissait d'un matériau visqueux et ce phénomène est particulièrement visible dans l'Himalaya, où l'Everest, la plus haute montagne du monde (8 849 m), a atteint un équilibre entre sa croissance et son effondrement gravitationnel. Un autre cas très visuel serait celui du bassin central du Groenland.