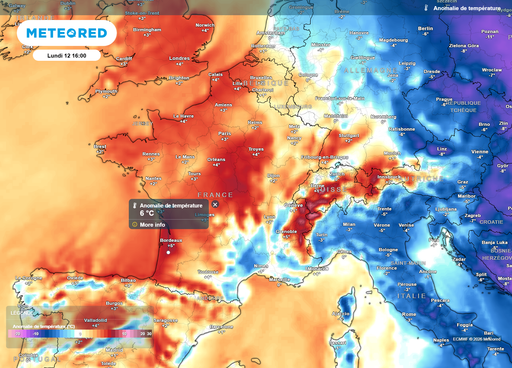Des composés toxiques peuvent passer des boîtes de conserve à votre assiette. Voici comment les éviter.
Pratiques et durables, pourtant les boîtes de conserve cachent des substances chimiques aux effets insidieux sur notre santé. Voici ce qu’il faut savoir pour mieux choisir… et mieux agir.

Les boîtes de conserve sont partout : dans nos placards, nos sacs de rando, nos garde-manger d’étudiants pressés. Elles conservent efficacement les nutriments, sont recyclables, et permettent de consommer hors saison. Bref, elles semblent parfaites. Pourtant, certaines substances chimiques contenues dans leurs parois peuvent migrer vers les aliments, et donc, vers notre organisme.
Cette réalité, bien que discrète, est aujourd’hui scrutée à la loupe par la communauté scientifique, notamment par le groupe de recherche FoodChemPack de l’Université de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Un système bien rôdé, mais pas sans faille
Avant d’atterrir sur nos étagères, les aliments subissent tout un processus avant une mise en conserve : blanchiment, mise en boîte, puis chauffage à plus de 100 °C pour éliminer les bactéries. À l’intérieur des boîtes métalliques, une couche protectrice empêche les aliments de toucher directement l’aluminium ou l’acier. Cette barrière, souvent composée de résines époxy, joue un rôle clé dans la conservation des aliments… mais aussi dans leur contamination.
Ces résines contiennent fréquemment du bisphénol A (BPA), un composé chimique utilisé depuis le XIXème siècle dans la fabrication des plastiques et résines. Il les rend résistants à la chaleur et à la corrosion, et permet une bonne adhésion aux surfaces métalliques. Le BPA est donc omniprésent : canettes, boîtes de conserve, ustensiles de cuisine, gobelets, lunettes, téléphones, jouets... Il est utilisé dans près de soixante secteurs industriels selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses).
Un danger réel
Selon les chercheurs, la biodisponibilité de ces substances, c’est-à-dire la part réellement absorbée par l’organisme, augmente de manière significative quand elles sont consommées avec des aliments riches en graisses (thon à l’huile, plats en sauce). Le BPA passe facilement dans les aliments, surtout quand la boîte est chauffée .
En simulant la digestion humaine grâce au protocole INFOGEST, ils ont aussi observé que les enfants et les personnes âgées, au pH gastrique plus élevé, seraient plus vulnérables. La migration chimique de ces substances dans la nourriture est bien documentée.
Même si les doses sont faibles, l’effet cocktail, accumulation de plusieurs substances perturbatrices, augmente les risques. Le BPA mime les œstrogènes et interfère avec notre système hormonal, même à très faibles doses. André Cicolella, toxicologue et auteur de Toxic Planet, alerte depuis des années sur cette menace sanitaire insidieuse.
Les effets suspectés, principalement observés chez l’animal mais corroborés par des données épidémiologiques, sont inquiétants : baisse de fertilité masculine, puberté précoce, troubles du métabolisme, atteintes du système immunitaire, effets sur le cerveau et le comportement, cancers hormonodépendants (sein, prostate). Il franchit également la barrière placentaire, ce qui rend l’exposition particulièrement préoccupante pour les femmes enceintes et les jeunes enfants.
Une réglementation lente à se mettre en place
Le BPA est interdit dans les biberons depuis 2011, puis dans tous les conditionnements alimentaires en France depuis 2015, avec une interdiction anticipée dès 2013 pour les produits destinés aux moins de 3 ans.
Mais la loi a mis du temps à être appliquée. Et pendant cette période transitoire, la population restait exposée. Pire encore, certains substituts au BPA, comme le cyclo-di-BADGE, n’ont pas encore été pleinement évalués sur le plan toxicologique.
Depuis le 1er janvier 2024, la Commission européenne a interdit l’usage du BPA dans tous les matériaux au contact des aliments. Un progrès, certes, mais les alternatives ne sont pas toujours exemptes de risques, faute de recul scientifique.
Comment faire pour réduire les risques ?
Faut-il pour autant bannir toutes les conserves ? Pas forcément. Il s’agit plutôt d’adopter quelques réflexes simples pour limiter l’exposition :
- Ne chauffez jamais une conserve dans sa boîte.
- Évitez de consommer le liquide (huile, sauce) contenu dans les boîtes.
- Privilégiez les bocaux en verre, les aliments frais, surgelés ou fermentés.
- Inspectez les boîtes : rejetez celles qui sont cabossées ou rouillées.
- Évitez les plats cuisinés en barquette plastique, surtout pour les enfants.
- Utilisez des ustensiles en verre, inox ou porcelaine, surtout pour réchauffer les aliments.
Des plateformes en ligne recensent des alternatives sans danger, y compris pour les gourdes, saladiers ou lunch-box.
Référence de l'article
The Conversation. (2025, 30 mai). Harmful chemicals often migrate into tinned food – here’s how to avoid eating them.