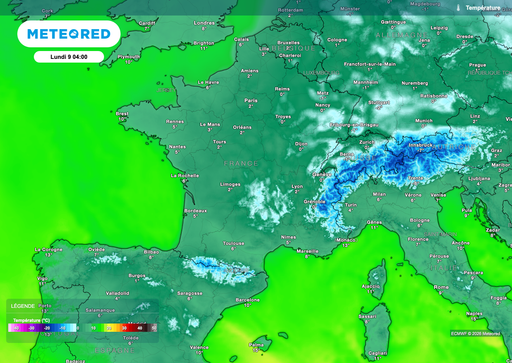Comment prétendre financer la transition quand les « fonds durables » investissent encore dans les fossiles ?
Vous pensez investir pour le climat ? Une analyse rigoureuse montre que de nombreux fonds « durables » financent encore le pétrole, le gaz et les industries polluantes. Tout le système financier résiste à la transition.

« Durable », « responsable », « vert ». Ces mots rassurent, séduisent, donnent l’impression d’agir pour le climat sans renoncer à la performance financière.Une analyse scientifique récente démonte patiemment les mécanismes d’un marché qui promet beaucoup, mais transforme peu.
En décortiquant le fonctionnement réel des fonds « verts », cette étude met en lumière non pas quelques dérives isolées, mais un problème structurel : la finance durable, telle qu’elle existe aujourd’hui, est largement incompatible avec les exigences de la transition climatique.
Des promesses vertes aux contours flous
« Fonds durables », « fonds verts » : les appellations se multiplient, mais aucune définition claire et consensuelle ne s’impose. Même la Banque de France s’appuie sur une notion floue d’« intérêt collectif à long terme », profondément subjective. Ce qui se traduit par une offre abondante, confuse, parfois contradictoire, souvent éloignée des attentes réelles des épargnants.
Cette ambiguïté ouvre la voie à des situations déroutantes. TotalEnergies figure dans des fonds dits durables. Coca-Cola obtient une notation ESG AAA chez MSCI, leader mondial de la notation extra-financière, malgré des impacts environnementaux majeurs.
Pourquoi ? Parce que l’ESG mesure avant tout les risques financiers pour l’entreprise, et non ses effets sur le climat ou les écosystèmes. Une confusion fondamentale, mais redoutablement efficace sur le plan commercial.
Le cœur du problème : rendement maximal contre durabilité réelle
L’étude est sans détour : produire de façon durable coûte plus cher. Comme rejeter des polluants dans une rivière plutôt que de financer un système de traitement, l’option la moins chère reste souvent la plus polluante. La vraie question n’est donc pas technique, mais politique et économique : qui paie le coût réel de la durabilité ?
Or, la finance est verrouillée par un principe central : la responsabilité fiduciaire. Les gestionnaires d’actifs doivent servir en priorité l’intérêt financier de leurs clients. Toute ambition environnementale reste subordonnée à la performance.
Sortir de ce cadre, c’est accepter de sacrifier du rendement, et donc une large part de l’attractivité commerciale du fonds. Voilà pourquoi le triptyque « rendement maximal + impact réel + bonne conscience » est, selon l'auteur de cette étude, structurellement impossible.
Une promesse largement illusoire
La majorité des fonds durables investissent sur les marchés secondaires, en achetant des actions ou obligations déjà émises. Ces flux n’ont aucun effet direct sur les décisions d’investissement des entreprises. Cela veut tout simplement dire qu'acheter une action « verte » ne rend pas une entreprise plus verte.
Même les obligations vertes n’échappent pas à cette limite. Le marché ne valorise que le risque de crédit, pas l’utilité climatique du projet financé. Le fléchage vert relève donc surtout de la communication : tout le passif d’une entreprise finance l’ensemble de son activité, verte ou non.
Quand la finance durable s'autocensure
Face à ces limites, les outils mis en avant par la finance durable peinent à convaincre. Engagement actionnarial, exclusions sectorielles, labels : tous sont contraints par la même ligne rouge, ne jamais menacer la rentabilité. Les votes des actionnaires sont non contraignants, les exclusions réellement ambitieuses rendent les fonds invendables, et certaines exclusions se redessinent au gré des opportunités de marché.
Cette plasticité éthique va parfois très loin. L’étude montre que des acteurs de la finance durable font du lobbying en faveur de l’industrie de l’armement, au nom d’une durabilité opportunément redéfinie. Une illustration frappante de ce que l'auteur décrit comme un greenwashing systémique, où l’éthique s’adapte aux contraintes financières, jamais l’inverse.
Une impasse réglementaire et un choix de société
La réglementation européenne repose sur une hypothèse fragile : croire que plus de transparence suffira à réorienter les capitaux. Toutefois, informer n’est pas transformer. La taxonomie européenne, la CSRD ou la Directive sur le reporting de durabilité des entreprises, et le Règlement sur la publication d’informations en finance durable (SFDR) ont été progressivement vidés de leur ambition initiale par des compromis politiques, au point que le cadre réglementaire s’aligne aujourd’hui sur les pratiques existantes au lieu de les transformer.
Tant que la responsabilité fiduciaire imposera la maximisation du rendement, l’impact environnemental restera secondaire. Continuer à faire la même chose en espérant un résultat différent relève moins de la naïveté que du déni.
Changer de trajectoire implique d’accepter une vérité inconfortable mais fondamentale : une transition réelle nécessite une action publique forte, capable d’imposer des règles contraignantes, de répartir les coûts et de sortir la finance de son rôle de vitrine morale. La finance peut accompagner la transition, mais elle ne la déclenchera pas seule.
Référence de l'article
Lefournier, J. (2026, 28 janvier). Les fonds durables : le grand enfumage. Bon Pote.